LE PAYS VOIRONNAIS
L'ENERGIE AU SEIN DES SITES INDUSTRIELS
-
LES VIEUX MOTEURS HYDRAULIQUES
ET LES AUTRES
*
Version de 2011
1-L'ENERGIE
Consulter :
SCHRAMBACH A. Les roues
hydrauliques. 156 pages 2009
SCHRAMBACH A. Les moteurs autres
que les roues hydrauliques. 142
pages 2010
- Livres édités par la Fédération Française de sauvegarde des Moulins,
Musée des Arts et Traditions Populaires Paris XVIe (direction@moulinsdefrance.org)
____
SCHRAMBACH Alain Comment accroître l'énergie disponible dans un atelier, une usine . 2005 non publié.

Fig : Dans les deux vallées
fortement industrialisées, la Fure et la Morge - celà est moins marqué dans les autres vallées - au
virage XIXe - XXe siècle,
l'énergie
hydraulique qui avait été toujours l'énergie largement prépondérante atteignit
ses limites.
La fée
électricité arriva au bon moment. Production locale dans les usines (éclairage)
puis apparition dans les années 1903 (limité à 2 vallées)
et
surtout 1920 de réseaux de distribution régionaux (éclairage et énergie
motrice).

Fig :
A Fures, le vieux canal des moulins comporte toujours un aqueduc multi
voûtes en plein cintre. Construit sur un rebord de terrasse alluviale,
il
pourrait - d'après l'architecture - dater du XVIIIe siècle. Ouvrage coûteux, il
a du être réalisé pour des forges.
Il fut
utilisé au XXe siècle (avec 7 roues hydrauliques de plusieurs types "en
dessous", "au dessus" et "de poitrine")
pour divers ateliers (mécanique, menuiserie etc).
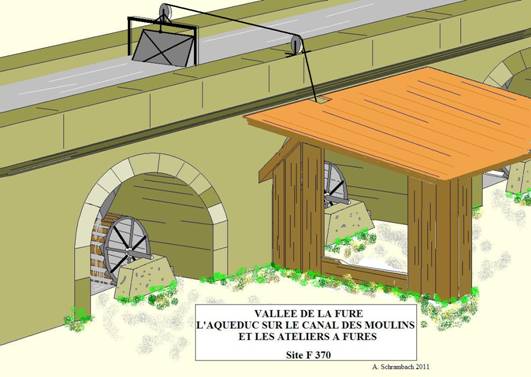
Fig : les ateliers sur l’aqueduc de l’image précédente
Consulter : SCHRAMBACH Alain Utilisation avant le XXe siècle des fortes dénivelées dans
les usines et
les ateliers situés autour du lac de Paladru (Isère) Décembre 2003 non publié.
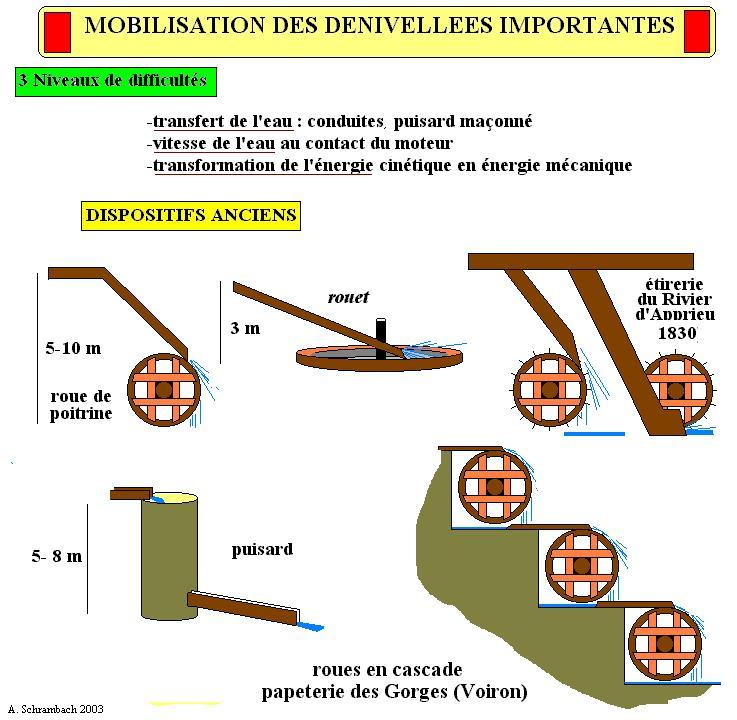
Fig : Le dispositif "en cascade" fut le plus efficace car le débit total était
dirigé sur chaque roue et ces dernières ne se gênaient pas : la puissance
disponible était toujours égale à la puissance équipée (pour un
débit donné). Il fut utilisé dans de vieux moulins alimentaires (Ainan et haute
Bourbre)
et à la papeterie des Gorges (Guérimand) à Voiron.
SCHRAMBACH Alain Les réseaux électriques dans les vallées autour du lac de Paladru Chroniques Rivoises mai2005.
2-LES MOTEURS
Durant l'étude du Patrimoine Industriel des vallées, plusieurs vieilles turbines ont été décrites (Canson, Fontaine, Francis à opercules, Francis sur chambre d'eau, Girard , roue turbine Bergès, Pelton).
Quelques roues hydrauliques subsistent mais de nombreuses furent citées par les habitants ou bien sont mentionnées dans les archives (roüet, roue "au dessus", de "coté", "au dessous"ou de "poitrine").
A
consulter au Musée Dauphinois et à
A. SCHRAMBACH
Les roues hydrauliques, les turbines et les machines qu'elles entraînent.
L'exemple de la vallée de
La seconde édition est complètement modifiée et complétée (350 pages, 2006). Elle permet d'aborder tous les problémes de détermination, de compréhension et d'utilisation des moteurs vus et étudiés dans les vallées.
Durant une décennie d'enquêtes sur le terrain, de nombreux moteurs hydrauliques ont été découverts et décrits : rouets en bois et bois-métal, roue hydraulique de coté en bois et moyeu en fonte moulée (cette unique roue a été détruite durant l'hiver 2000-2001), roues au dessus, métalliques, de conception moderne. Des turbines ont été également décrites : Canson, Girard, Fontaine, Francis à opercules, Francis sur chambre d'eau, turbines à bache spiraloïde (Francis) et Pelton. L'étude décrit ces moteurs, donne les formules de calcul de la puissance de chaque type de moteur et les situe dans leur contexte historique.
Consulter également :
A. SCHRAMBACH, Histoire industrielle des vallées : les vieilles turbines hydrauliques
des vallées de l’Ainan et de

Fig : Cette évolution des moteurs
hydrauliques à la taillanderie Bret montre le passage des roues
hydrauliques mal étudiées de 1815 et d'avant (et de faible rendement),
aux roues de 1850 performantes, puis aux
roues-turbines et enfin aux turbines sur chambre d'eau à la fin du XIXe siècle.
LES ROUES HYDRAULIQUES
De nombreuses roues hydrauliques furent utilisées (parfois jusqu'aux années 1950 dans les forges et 1970 dans les moulins).
Les roüets (rouet) à axe vertical dominaient depuis de nombreux siècles dans les vieux moulins.
Avant 1850 dans les autres ateliers (en particulier les métallurgiques) il y avait des roues à axe horizontal mais on ne faisait guère la distinction, quand au rendement, entre les roues "au dessus", de "poitrine" ou "de devant" et "en dessous".
Après 1850, les roues "au dessus" bien
étudiées et efficaces devinrent prépondérantes. Les roues "de coté"
apparurent - semble-t-il - plus tardivement.
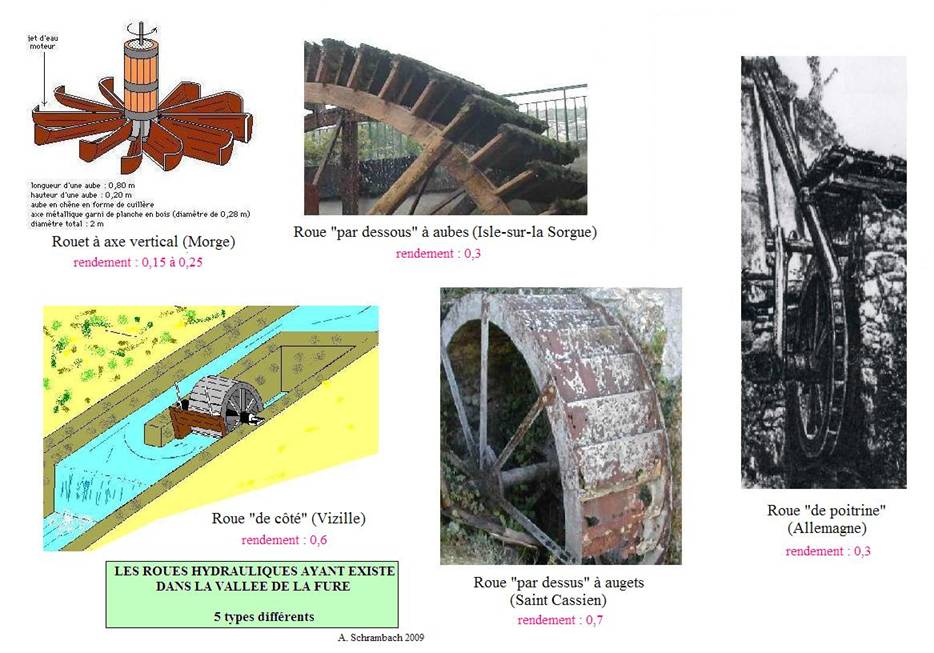
a) ROUE HYDRAULIQUE A AXE VERTICAL ou ROUET (roue à impulsion)

Fig :
Le roüet (roue hydraulique à impulsion et axe vertical) fut le moteur universel
des moulins car, en général, l'axe du moteur étant commun avec
celui
de la paire de meules horizontales, l'entraînement était direct.
Le dessin montre bien qu’avec une roue à
impulsion les pertes d’eau (dont
l’énergie cinétique n’est que partiellement communiquée à la roue)
sont
importantes :
le rendement du moteur chute en conséquence.
b) ROUE HYDRAULIQUE A AXE HORIZONTAL

Fig : Ce tableau montre les
diverses sortes de roues à axe horizontal.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- l’emplacement du point de
contact eau-moteur par rapport à l’horizontale passant par l’axe de
la roue
- le mode de présentation de
l’eau : béal incliné ou horizontal
- la nature des réceptacles de
l’eau : aubes ou augets
- le diamètre de la roue
Pour déterminer le rendement du
moteur, il faut faire intervenir tous ces éléments.
Autrefois, les moteurs les plus prisés
étaient ceux à impulsions, où l’eau arrive
à grande vitesse par ce que le béal est incliné. Comme déjà expliqué (voir le rouet) ce choix est à proscrire. Les
études faites à la fin du XVIIIe siècle explicitèrent cette conclusion mais il
fallut attendre le milieu du XIXe siècle pour que les roues à axe horizontal
alimentées par un béal horizontal et du type « par-dessus » donc avec
des augets, équipent majoritairement les usines.
Si depuis l’époque Médiévale, les
vieilles roues étaient construites en bois, celles mixtes (bois, fonte) puis
fonte, acier ne furent largement employées qu’à partir des années 1880.
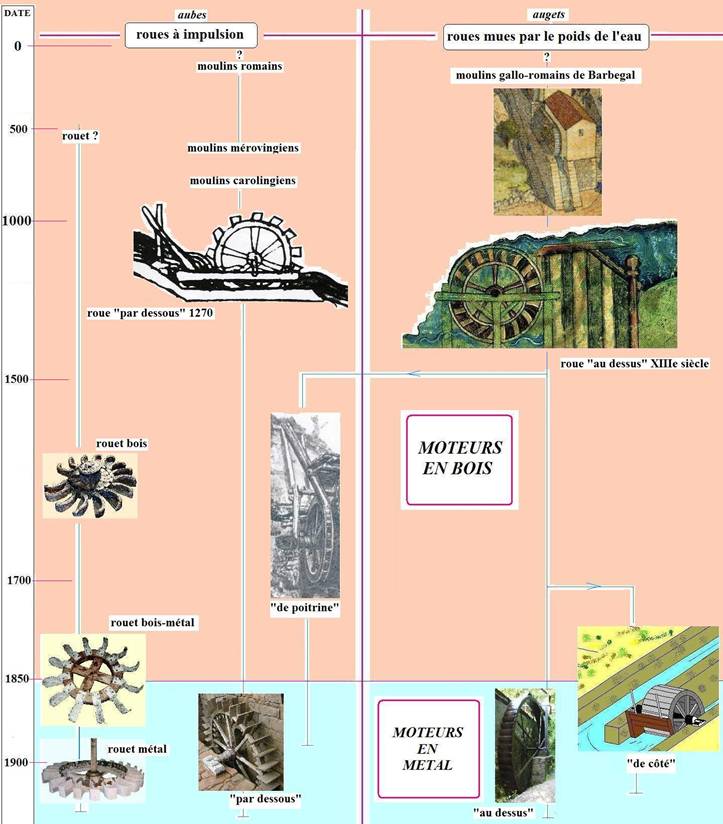
VIEILLES TURBINES
Les turbines (turbines Canson) apparurent
dans les vallées du Voironnais à la fin des années 1840 (chez Gourju à
Bonpertuis dans
Dans les deux cas, abandon des roues hydrauliques à
impulsion, abandon des roues au profit des turbines, le poids des coutumes, de
l’habitude, pesa lourd dans la décision de changement des patrons de
manufacture (il faut y ajouter le coût de l’opération).
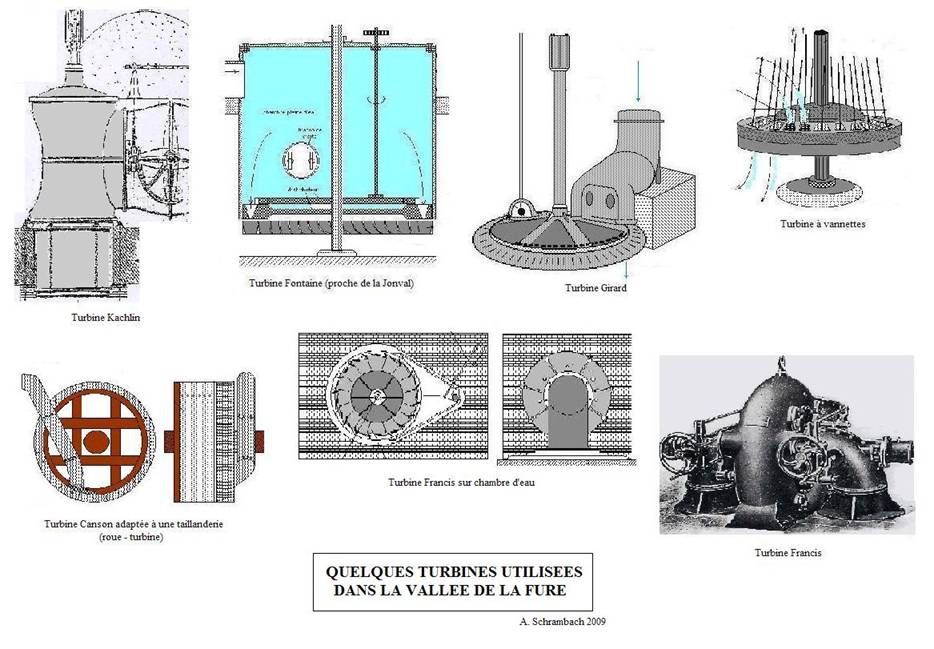
LES VIEILLES TURBINES VUES ET ETUDIEES DANS LES ATELIERS ET USINES
(1993 à 2003)
Roue-turbine Bergès (principe Canson) : axe vertical, alimentation incomplète, flux centrifuge H130, citée au F40
Canson : axe vertical, alimentation partielle, flux centrifuge : B65, citée au F230
Fontaine : axe vertical, alimentation partielle, flux axial : H100
Francis : axe vertical, à opercules (ou à vannettes), flux axial, alimentation partielle : F430, H110, citée au A150
Francis : axe vertical, flux axial : F40, F400
Francis : axe horizontal, flux centripète, sur chambre d'eau : A190, F40, F260 aval, F270, F340, H90
Girard : axe horizontal, alimentation partielle, flux centrifuge : A190, F55, filature de Chatte
Girard : axe vertical, alimentation partielle, flux axial : A80, P100, H150
Pelton : axe horizontal, injecteur : H430, P140
A = Ainan, B = haute Bourbre, F= Fure, H= Hien, P= bassin du lac de Paladru,
LES CONSTRUCTEURS DE TURBINES
Lors
de l'enquête du Patrimoine Industriel dans la vallée de
ont été relevés sur les plaques signalisatrices scellées sur les moteurs.
Site, marque ou fabriquant et année :
F40, Magnat Simon
F60, BSD 1929
F110, Simiand 1944
F120, Bouvier
F130, Dumont 1948
F202, Neyret Grenier 1911
F240, Bouvier 1903
F260, Magnat Simon
F290, Magnat Simon
F300, BSD
F310, Magnat Simon
F350, Neyrpic 1956
F360, BSD 1951
F400, societé Alsacienne de Construction Mécanique 1930
F410, Magnat Simon 1930
F420, Brenier et Neyret 1885 (?)
F230 : Canson (Annonay) 1849
Les numéros des sites sont ceux donnés aux usines lors de l'enquête, sur le terrain, du Patrimoine Industriel (1993-94)
On retrouve les mêmes sociétés dans la vallée de l'Ainan, les constructeurs étant fréquemment installés dans le Dauphiné.
De vieilles turbines ont été étudiées.

Fig :
Les taillanderies, à Montagieu (Hien), à Charavines (Fure), à la Tivollière
(Voiron), à l'Ourcière (Allevard) et dans la Gallaure furent équipées
à la
fin du XIXe siècle par des turbines type Canson particulières.
Afin de ne pas modifier les outils de production - les martinets - on conserva
l'arbre de couche (diamètre de
De véritables
turbine Canson furent utilisées dans la Fure (dès 1849) et dans la
haute Bourbre à Pupetière.
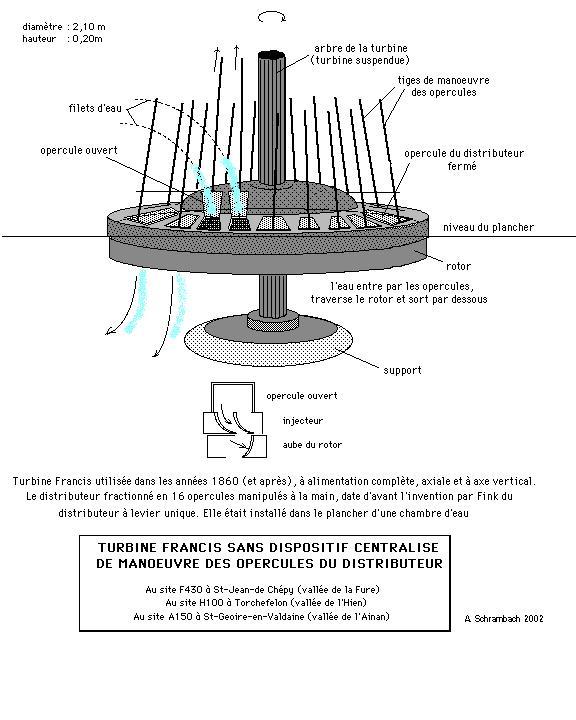
Fig :
Les turbines à vannettes (axe
vertical, écoulement axial, alimentation en principe complète) équipaient une
usine d'effilochage à St-Jean-de-Chépy (Fure),
une
papeterie à la Pale (Ainan) et une usine de tissage à la Rosetta St-Bueil
(Ainan)
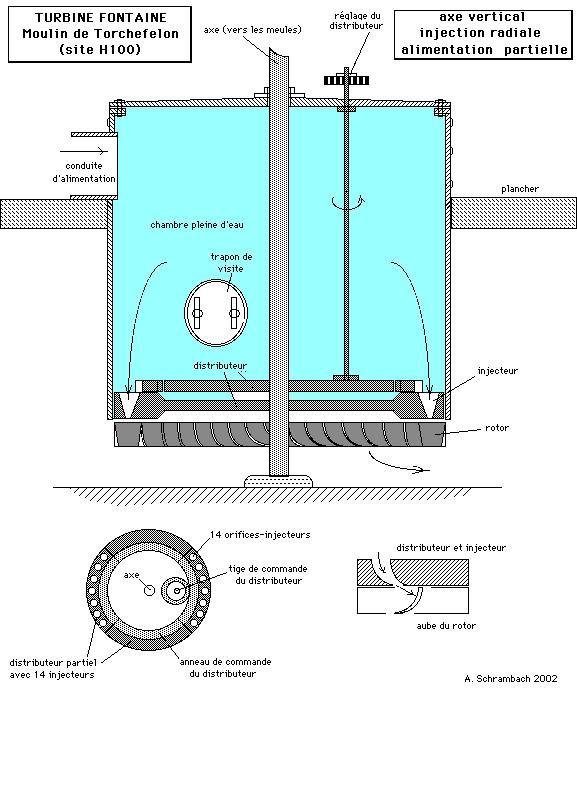
Fig :
Une turbine Fontaine, dérivée de la turbine Fourneyron
– autre turbine à cuve - (axe vertical, flux
axial, alimentation incomplète)
existe
dans un ancien moulin à Torchefelon (Hien)
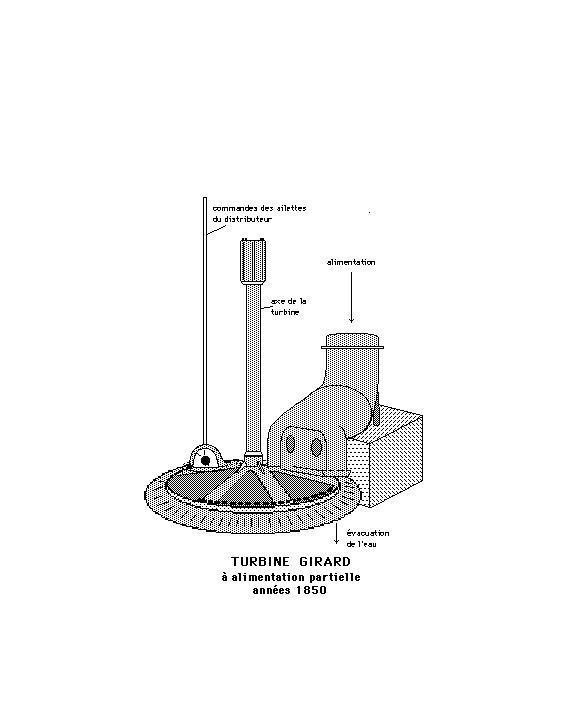
Fig :
Deux grandes turbines Girard à axe vertical, flux axial, alimentation incomplète, sont encore
visibles dans un tissage de la vallée de l'Ainan et un autre dans l'Hien.
D'autres
à axe horizontal ont été découvertes dans l'Ainan, la Fure et dans la Galicière
à Chattes.
TURBINES MODERNES
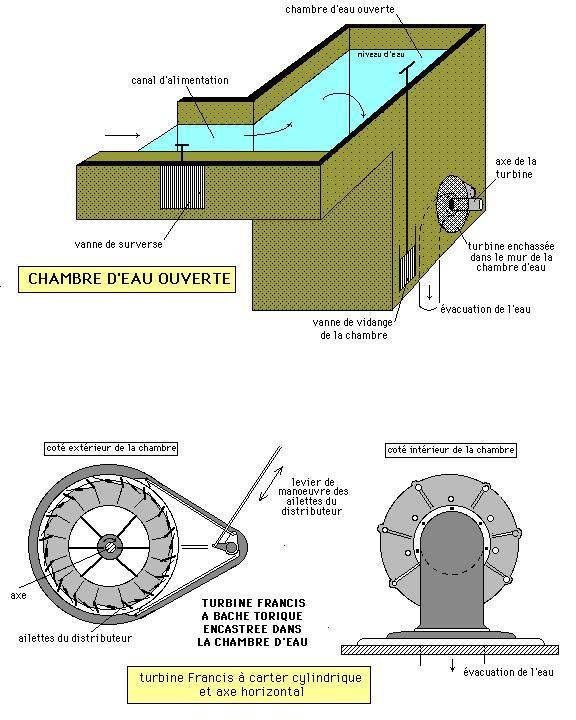
Fig : Dans toutes les vallées les turbines Francis
(avec un aspirateur et une bâche torique non spiraloïde) installées sur une
chambre d'eau sont nombreuses.
Les turbines Francis à bâche spiraloïde
alimentées par une conduite, les Kaplan et les petites Pelton
sont également présentes.
MOTEURS D'APPOINT NON HYDRAULIQUES
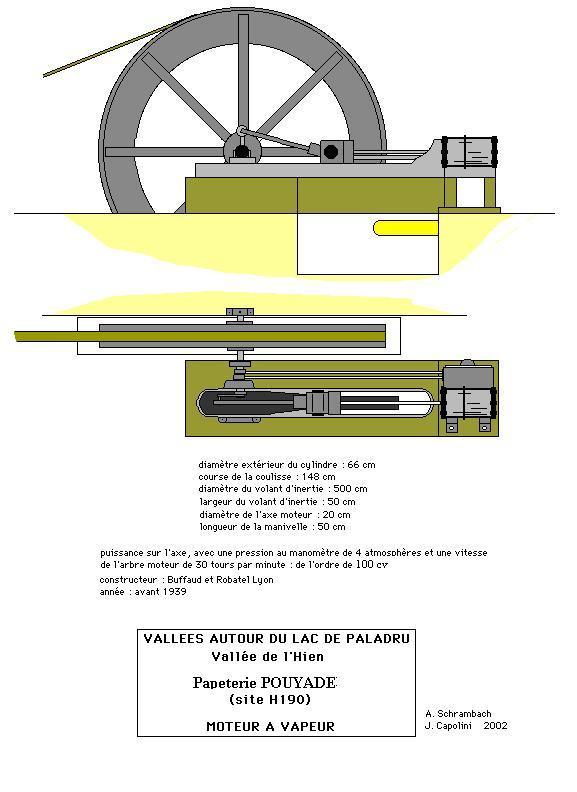
Fig :
Cette machine à vapeur, qui date de la fin des années 1930, existe encore dans
un salle de l'ancienne papeterie Pouyade à St-Victor-de-Cessieu (vallée
de l'Hien).
Les machines à vapeur, peu utilisées dans le Voironnais (moteur d’appoint en cas de basses eaux, d’éclusage) ne délivraient qu’une puissance faible (7 à 8 CV en moyenne).
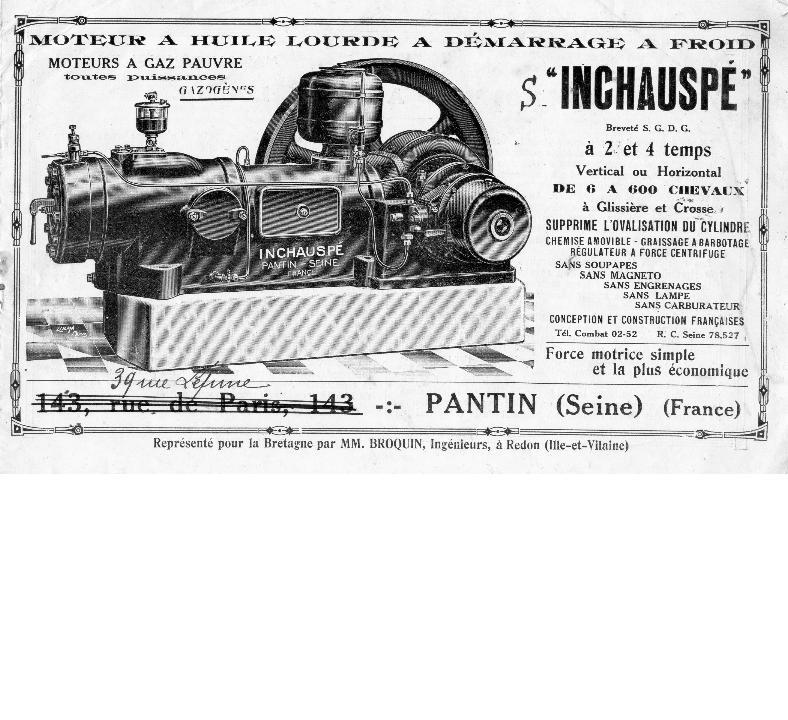
Fig :
Les moteurs à huile lourde
étaient utilisés parfois dans les moulins et les usines de tisssage comme
moteur d'appoint utilisés durant les étiages
ou
pour compenser les inconvénients des éclusages
pratiqués par les industriels installés en amont.
(document
transmis par Mr. Inchauspé fils)
Manège à cheval
Les tuileries pouvaient être équipées d'un manège à cheval (comme une huilerie à Biol) ou d'une roue hydraulique (à St-Joseph-de-Rivière) pour entrainer la malaxeuse d'argile
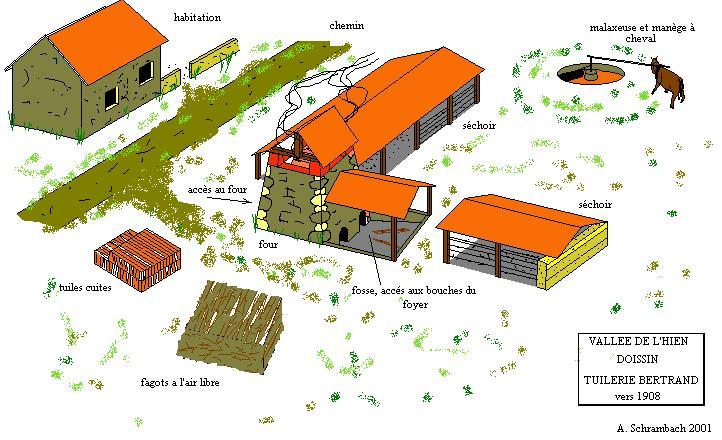
Fig :
un cheval entraîne le malaxeur à argile
3-Les moteurs entraînaient les machines de diverses manières
D'abord jusqu'au milieu du XIXe siècle, les roues hydrauliques étaient dédiées à 1 machine avec, si possible une liaison directe sans engrenages. C'est le cas des paires de meules à la française, dont l'axe était commun avec celui du rouet. Il en est de même pour les martinets reliés à une roue à axe horizontal (en dessous ou de poitrine puis au dessus).
Plus tard les roues bien étudiées (en dessus ou de coté), puis les turbines, pouvaient entraîner plusieurs artifices. La liaison se faisait comme montré dans les deux figures suivantes.

Fig : Les moteurs étaient en sous sol et la
"remontée" d'énergie se faisait par des courroies et des poulies
plates en bois qui circulaient de bas en haut
par une chambre verticale sans plancher ni plafond. Ce
système existe encore à l'usine de tissage de la Grande Guillionnières (F145)
et à celle de Champet (A145).
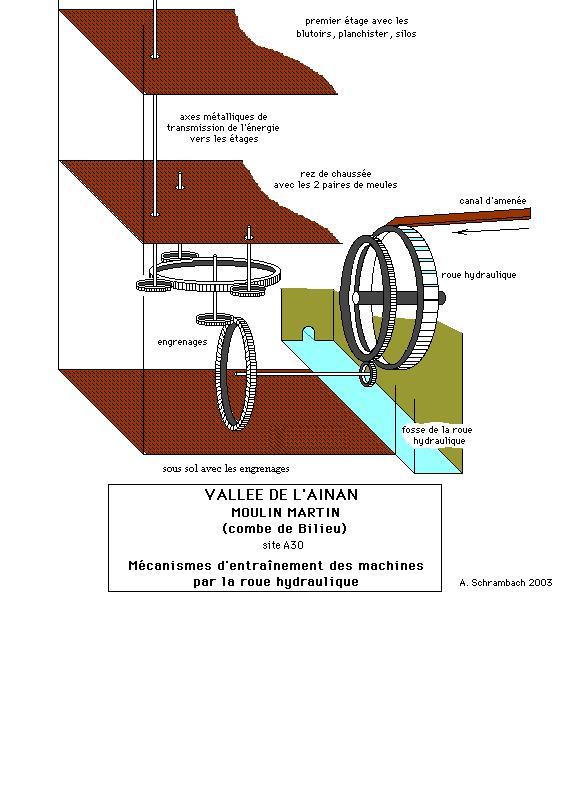
Fig : L'autre dispositif consistait en un axe en
acier forgé qui reliait la source d'énergie en sous sol aux étages.
Ce dispositif existe encore dans le moulin Martin
(A30) et dans la vallée de l'Hien.
Un engrenage de grand diamètre, directement branché sur l'axe
de la roue hydraulique, faisait tourner un petit
engrenage qui accroissait la vitesse de rotation. En effet la roue tournait
très lentement.
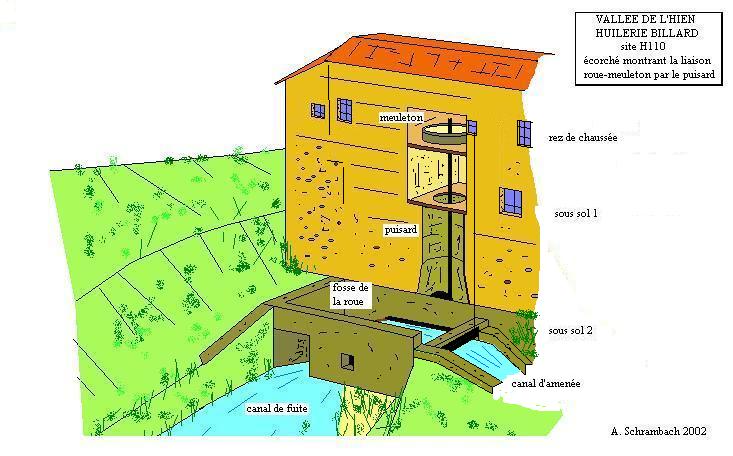
Fig : La scierie Billard, à Montagnieu, comprenait une annexe "huilerie". La
liaison roue hydraulique-meuleton situé
par un puisard creusé dans le rocher, sous le
bâtiment, avec un axe en acier forgé qui existe encore.

Fig :
Dans la filature de la Galicière à Chatte, les moulins à soie étaient entraînés par un ensemble
de tiges en acier forgé qui couraient au ras du sol des
engrenages
principaux jusqu’aux moulins. Ceux ci, datant des années 1820, ne
comprennent aucune pièce en métal.
Tous
les engrenages (alluchons) sont en
bois dur (buis)
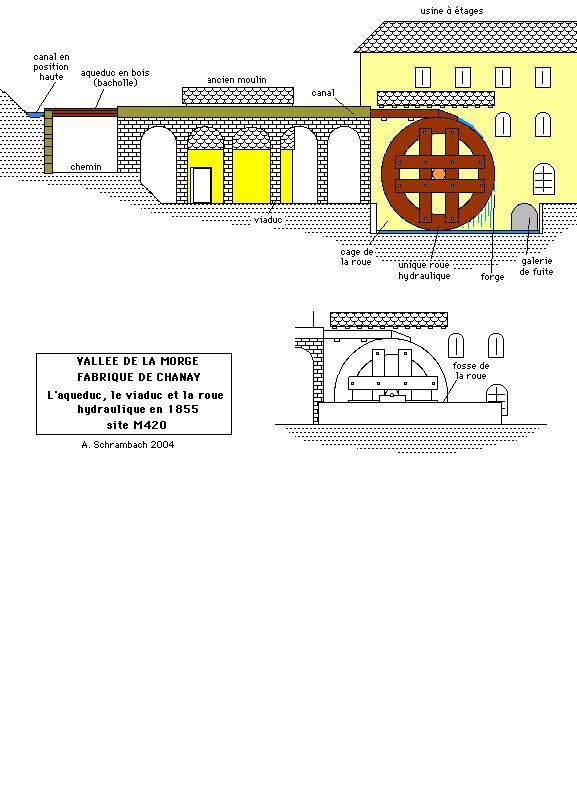
Fig : Le premier moteur de l'usine de
tissage de Saint-Nicolas-de-Macherin ainsi que l'aqueduc d'amenée de
l'eau ont été reconstitués
en s'appuyant sur des relevés topographiques, des
observations archéologiques, des photographies et des archives.
Cette construction (roue hydraulique en chêne de
cliquez ICI pour le retour au
MENU PRINCIPAL
ou FIN